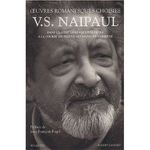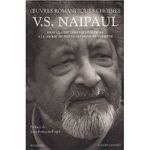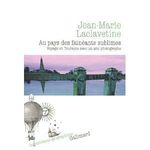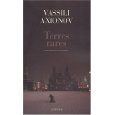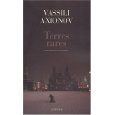 "Terres rares" de Vassili Axionov
"Terres rares" de Vassili Axionov
2 étoiles
Actes Sud, 2009, 396 pages, isbn 9782742780433
(traduit du Russe par Lily Denis)
C'est une fable alchimique sans doute que ces "Terres rares" contant l'histoire - bref, les amours, les succès et les échecs - de quelques oligarques russes actifs dans le secteur des terres rares - scandium, yttrium et le groupe des lanthanides, éléments essentiels à de nombreuses applications de l'industrie contemporaine -, et dont l'ascension fut aussi fulgurante que ne fut brutale ensuite leur chute vers les geôles d'un pouvoir fort peu enclin à perdre le contrôle de certains secteurs stratégiques, nonobstant la libéralisation affichée de l'économie ex-soviétique.
Fable alchimique aussi, car elle nous montre un écrivain au travail, Basile ou Bazz Oxelotl, alter ego de l'auteur, à l'affût des mille et un détails de sa vie quotidienne susceptibles de lui amener une étincelle d'inspiration, et les métamorphoses que subit ensuite cette timide lueur jusqu'à s'étirer sur des pages, et des pages et des pages... Fable boulgakovienne, nous annonce la quatrième de couverture, car ce livre nous plonge, tout comme "Le maître et Marguerite", dans la cuisine intérieure d'un écrivain confronté à un monde en pleine mutation, en l'occurrence dans le cas des "Terres rares" à la libéralisation finalement pas si libérale de l'économie russe.
Mais qu'est-ce qu'on est loin de la drôlerie, de la prodigieuse inventivité et du tourbillon d'émotions de l'ultime chef-d'oeuvre de Mikhaïl Boulgakov! Et excusez-moi, mais c'est que le mot "ennui" serait beaucoup trop doux pour évoquer ce que j'ai éprouvé à la lecture de ces "Terres rares", qu'est-ce qu'on s'emm...!
C'est que le dernier livre de Vassili Axionov, derrière ses ambitions affichées de s'ériger en hymne à la liberté créatrice de l'écrivain, fonctionne avant tout sur le mode d'une énumération qui culmine en une scène unique en son genre et où Bazz Oxelotl délivre des cachots d'une prison moscovite, outre le héros supposé des "Terres rares", l'interminable cortège des personnages des précédents romans de l'auteur (Vassili Axionov, donc, faut suivre...): énumération totalement dépourvue d'âme et où les personnages, tous les personnages y compris ceux des "Terres rares", se révèlent définitivement et irrémédiablement comme des pantins privés de vie et d'épaisseur.
Bref, le texte des "Terres rares" a beau fourmiller de jeux de mots, d'allusions drôlatiques et de trouvailles en tout genre, on s'y emm... (oui, j'y tiens) tant et si bien que vient un moment où le lecteur, littéralement assommé d'ennui, n'est plus là pour les savourer, présent peut-être de corps mais certainement plus d'esprit. Et en un mot comme en cent, c'est qu'en fin de compte, quoiqu'ait pu penser Vassili Axionov et quelques opinions qu'ait pu professer son alter ego Bazz Oxelotl (ce qui est peut-être, ou peut-être pas, une seule et même chose), it takes - always - two to tango...
Extrait:
"Mon oeuvre prenait des proportions, envahissait mes jours et mes nuits ou à l'inverse, c'étaient les événements qui s'accumulaient jour et nuit qui venaient la bousculer, et brutalement. En principe, rien ne m'oblige à me mettre à la traîne des événements réels. Je devrais m'en écarter le plus possible, ne reposer que sur mon imagination ou, comme disent les marins, "gagner au large". Mais d'autre par, je surprends de plus en plus souvent mes personnages principaux en train de poser sur moi des regards interrogateurs. Comme s'ils croyaient que je participe bel et bien aux événements et que mon imagination est un facteur réel de leur développement. "Le roman est une forme ouverte, dit Bakhtine il échappe à toute finalisation." En tant qu'auteur, j'applaudis à douze mains cette proclamation pleine d'audace. J'ai peine à imaginer un roman dont le plan serait établi en fonction de la fin. Je ne me figure même pas ce qui arrivera après le présent sous-chapitre que l'on pourrait intituler "Doutes de l'auteur en compagnie d'un âne". D'ailleurs, rien n'a impliqué la présence d'un âne au cours des deux cents quarante pages d'ordinateur qui précèdent, alors que, selon toute probabilité, il errait déjà avec son ancien maître le long de la frontière libre du pays, n'imaginant même pas qu'il deviendrait la cheville ouvrière, si petite soit-elle, d'une composition romanesque. Il en va de même de la métaphore. Finalement, qu'est-ce donc qu'un roman sinon une métaphore développée, une part de libre univers, tel que notre Réservoir, ou plaisanterie à part que l'Océan en son perpétuel mouvement." (pp. 257-258)
Un autre livre de Vassili Axionov, dans mon chapeau: "Les oranges du Maroc".
Et d'autres titres encore sont présentés sur Lecture/Ecriture, où Vassili Axionov était l'auteur des mois d'août et septembre 2009.
 "San Clemente",
"San Clemente",

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F3%2F137165.jpg)