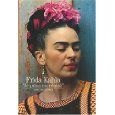"L'herbe qui ne meurt pas (Au-delà de la montagne, tome 3)" de Yachar Kemal
½ étoiles
Gallimard, 1983, 396 pages, isbn 2070299317
(traduit du Turc par Munevver Andac)
Voici venu le temps d'une deuxième rencontre avec l'auteur des mois d'avril et mai 2011, qui celle-là se révélera parfaitement catastrophique...
Sans doute faut-il attribuer au prix du meilleur roman étranger, qui avait couronné ce livre lors de sa parution en France en 1978, le fait que "L'herbe qui ne meurt pas", troisième tome de la trilogie "Au-delà de la montagne", se retrouve dans les collections de la bibliothèque que je fréquente, sans les deux tomes qui devaient le précéder ("Le pilier" et "Terre de fer, ciel de cuivre"). Il m'a donc fallu en quelque sorte sauter dans le train en marche en entamant ma lecture, mais ce fut pour m'apercevoir assez vite que cela ne posait guère de problèmes, tant les enjeux de ce livre sont simples, en fait: chaque été, les paysans du village de Yalak dans le Taurus sont obligés – pour gagner de quoi rembourser leurs dettes au terrible Adil Effendi - de se louer comme journalier dans la plaine de la Tchoukourova, pour la cueillette du coton. Et chaque été, ils traînent dans leur transhumance les divers griefs, les motifs de jalousie, les haines, les rancoeurs et les désirs de vengeance de la vie au village. "L'herbe qui ne meurt pas", c'est tout simplement cela: une histoire de vengeances (où le pluriel est significatif).
Voilà pour planter grossièrement le décor de ce billet qui sera sans doute le plus assassin de tous ceux que j'ai pu écrire en tout de même quelques années de critique (je n'aime pas trop ce mot, mais enfin gardons-le faute de mieux...) littéraire sur la toile. Et dont j'espère qu'il le restera, car rarement lecture m'a-t-elle à ce point ennuyée, énervée et finalement laissé complètement écoeurée!
Une lecture ennuyeuse, donc, pour commencer. Car je n'avais pas encore franchi le cap de la page 100 que je n'en pouvais déjà plus de m'entendre répéter jusqu'à plus soif que
- les champs de coton de la Tchoukourova étaient comme une steppe couverte de neige
- les chemins et les sentiers dessinaient dans la plaine une toile d'araignée
- le fleuve Djeyhan s'écoulait dans la plaine (sans bornes, forcément, et ressemblant à une steppe couverte de neige à cause des champs de coton, mais ça, je vous l'avais déjà dit...) comme un ruban d'argent en fusion, tandis que les aigles tournoyaient au-dessus des rochers de l'Anavarza
Et je vous épargne les métaphores suscitées par les hanches larges des femmes, tendant l'étoffe de leurs robes (comme quoi, autres lieux, autres canons de beauté féminine...), le parfum de la marjolaine, la chaleur écrasante, les moustiques etc, etc, etc... Inutile de compter sur quelque forme de suspense que ce soit pour soutenir l'intérêt, car la quatrième de couverture révèle en une petite page tout, absolument tout, de ce qui se passe tout au long de ces interminables 396 pages dont le reste n'est au fond que du remplissage: steppe couverte de neige, toile d'araignée, ruban d'argent et aigles tournant en rond. Inutile aussi de compter sur les personnages: les jérémiades de la souriante (sic) Gulbahar m'avaient déjà un tantinet agacée, mais que dire alors de Mémidik, mélange de bébé geignard, de crétin des Alpes et de brute épaisse, et de tous ses pays, qui n'ont au fond rien à lui envier. Bref, tout ça, c'est parfait, vraiment, pour tuer le temps, à supposer que ce soit ce que le lecteur souhaite, qu'il ne veuille vraiment rien de plus de ses heures passées à lire, car sinon, c'est bien le lecteur, pauvre de lui, qui risque de périr d'ennui!
J'en serais sans doute restée là - sur l'impression d'un ennui abyssal – si Yachar Kemal n'avait pas été notre auteur des mois d'avril et mai, et si un obscur sens du devoir ne m'avait pas poussée à continuer ma lecture malgré tout, non sans recourir à quelques trucs et astuces pour enrober cette amère pillule. Lire devant la télé allumée, intercaler une autre lecture entre deux chapîtres de cette herbe qui n'en finissait décidément pas de ne pas mourir, j'ai tout essayé, et c'est sans doute ce dernier procédé, et la compagnie – tellement plus intelligente, stimulante, agréable... tellement plus tout, en fait - de Nina Berberova, Francis Dannemark ou F. Scott Fitzgerald qui, par l'effet d'une comparaison devenue aussi inévitable qu'impitoyable, m'a fait passer de l'ennui à l'écoeurement pur et simple. Que ces 396 pages de médiocrité ronronnante aient pu se voir couronnées du prix du meilleur livre étranger passe ma compréhension. Que la quatrième de couverture tente de les vendre comme s'élevant "avec un inimitable naturel, aux dimensions de la légende" relève à mes yeux du mensonge éhonté. Et pour exprimer le fond de ma pensée, faut-il encore dire que le point d'interrogation dans l'intitulé de ce billet est purement rhétorique?
Extrait:
"«Et voilà, se dit-il. Quiconque viendra regarder à l'intérieur du puits pourra le voir... Et les gens ont coutume d'aller regarder dans les puits. Il n'est personne au monde qui n'aille aussitôt fourrer sa tête dans un puits. On s'y voit plus beau que dans un miroir et plus net.»
Mémidik regarda son propre visage, à côté de la tête au longues moustaches, tout au fond du puits. Un petit visage, gros comme le poing, brûlé par le soleil; les joues creuses, les yeux enfoncés dans les orbites. Son menton tressaillait.
«J'ai très peur, dit Mémidik à l'homme au fond du puits. Maudit sois-tu, tu ne me causes que des emmerdements. Que vais-je faire de toi? Où pourrais-je bien te transporter? Ils te trouveront partout où je t'emmènerai. Quoi que je fasse, ils sauront que je t'ai tué. Que vais-je faire de toi? Que pourrais-je bien faire? Dis-le moi donc, je t'en prie!»
Il se mit à pleurer. Et au fond du puits, son reflet pleurait aussi, la lèvre boudeuse comme celle d'un enfant, les yeux plissés. Et la tête aux grands yeux vitreux, aux longues moustaches, pleurait elle aussi." (pp. 97-98)
D'autres livres de Yachar Kemal, dans mon chapeau: "La légende du Mont Ararat" et "Tu écraseras le serpent"
 "The Good German" de Steven Soderbergh,
"The Good German" de Steven Soderbergh,

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F3%2F137165.jpg)