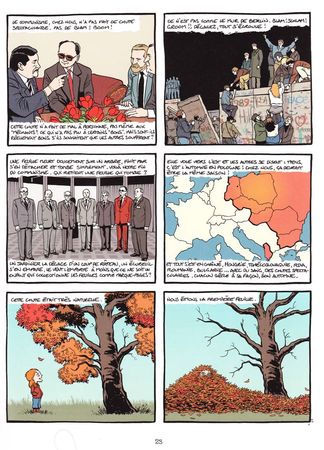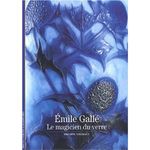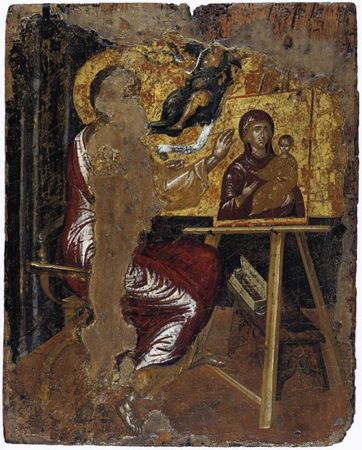"Le tombeau de Samson" de Philippe de la Genardière
3 étoiles
Actes Sud/Un endroit où aller, 1998, 133 pages, isbn 2742716645
Un tombeau, ce livre l’est au sens que Marin Marais ou Maurice Ravel auraient pu donner à ce mot, composant le premier son tombeau de Monsieur de Sainte-Colombe, le second son tombeau de Couperin: tout à la fois un hommage et l’apurement d’une dette. Et la référence musicale est tout à fait de circonstance car c’est de Samson François qu’il s’agit ici, pianiste touché par la grâce qui fut une véritable star dans les années d’après-guerre. Un pianiste au "jeu souverain, mais à sa manière à lui, qui plaît ou déplaît. A cause de la volupté, et de la liberté, à cause des deux mains décalées mais qui se jouent de tout, à cause de la poésie surtout, suprême, qui fait croire à la douceur des ténèbres – et par exemple, dans l’Etude en fa mineur de l’opus 10, qui fait frissonner tellement ça chante, tellement ça danse, et funèbrement. L’illusion est parfaite: on meurt, et c’est un bonheur!" (pp. 50-51)
C’est, tout d’abord, le récit d’un amour d’enfance et d’adolescence: l’amour qui foudroya un petit garçon de sept ans, à Bordeaux, en 1956, lorsqu’il entendit pour la première fois Samson François jouant Frédéric Chopin. Un amour jamais démenti pour celui qui devait incarner aux yeux de Philippe de la Genardière, tout au long de son enfance et de son adolescence, la rébellion, la liberté, le jeu face aux figures imposantes de ce qu’il dénomme l’instance, la triple figure du général de Gaulle, de Pablo Casals, maître respectueux du texte avant toute chose érigé en exemple devant le violoncelliste en herbe que l’auteur était alors, et d’un père, officier en Algérie et donc essentiellement absent… C’est alors un accès aux "choses cachées du monde (…), ce qu’un homme reçoit, ce qu’il en fait" (p. 59). Puis, bien plus tard, pour le petit garçon de Bordeaux devenu écrivain, c’est un idéal à atteindre: "écrire comme on joue d’un instrument – physiquement! Du moins comme Samson jouait du sien, à l’instinct et en s’exposant à des défaillances. Comme fit Glenn Gould aussi, dans un autre genre, moins romantique, et sur d’autres partitions, dans une autre "folie". C’est comme eux que vous voudriez écrire, sur un clavier en transe et avec des doigts de violoncelliste – sans jamais être sûr de jouer "juste". Car c’est là, dans l’incertitude du son, du corps, que ça se passe, vous en êtes sûr, dans un no man’s land." (p. 90)
Voilà un tombeau, donc, articulé en deux parties bien distinctes. La première, récit d’une enfance et d’une adolescence émerveillées par la musique, avec en arrière-plan une famille nombreuse – véritable tribu, que l’on devine chaleureuse, rassurante, encore que quelque peu étouffante – et une certaine bourgeoisie française en voie de disparition, un récit entre essai et autobiographie qui touchera les mélomanes, et les enfants qui n’ont pas tout à fait fini de grandir. Et la seconde, autoportrait d’un écrivain à l’ouvrage, dressant l’état de ses recherches et de l’idéal qui l’anime, coup d’œil indiscret jeté dans les cuisines et dont le pouvoir d’évocation ne donnera sans doute sa pleine mesure qu’aux yeux des autres cuisiniers, eux-mêmes familiers de l’œuvre obscure qui se joue là, mystérieuse au commun des mortels. C’est un tombeau, donc, hommage et reconnaissance d’une dette essentielle, et où chacun fera son miel selon ses goûts, et peut-être pas de tout…
Extrait:
"Et si on lui demandait, à cet enfant de Bordeaux qui a près de la cinquantaine aujourd’hui, pourquoi il l’aimait – lui – et entre tous, il ne saurait quoi répondre exactement. D’abord il bafouillerait, parlerait de "sensualité", de "suavité" – cette histoire de luge qui dévale les pentes enneigées des Pyrénées -, il évoquerait, tout en s’excusant, des images et des souvenirs d’enfance – à Bordeaux, dans les années cinquante – et tout en concédant que cette enfance ne porte qu’une minuscule part de vérité, qui est la sienne, qui n’a pas de valeur universelle, et à court d’arguments, tout à coup il lancerait des choses comme ça: "un jeu qui jubile" - "des mains qui chatouillent" - "des bordées dangereuses ou des ascensions périlleuses qui se terminent dans la volupté de l’arrivée" - "des vertiges affreux, soudain métamorphosés en extases"… Il essaierait de dire, cte homme de cinquante ans, la volupté des temps passés et au moment même où il le dirait, il se reprendrait à espérer dans cette volupté, alors il parlerait de "miracle", de "transe", il expliquerait que c’est l’"imperfection" même du jeu de Samson François qui était sa perfection.
Pour finir il aurait ce raccourci: "Il jouait pour son plaisir!"" (pp. 48-49)
 "Là-haut" des studios Pixar,
"Là-haut" des studios Pixar,

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F3%2F137165.jpg)