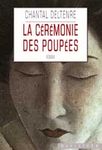Intime et distancié
"L’amour des Maytree" d’Annie Dillard
4 ½ étoiles
Christian Bourgois, 2008, 278 pages, isbn 9782267019827
(traduit de l’Anglais par Pierre-Yves Pétillon)
Une rencontre, des fiançailles, un mariage, la naissance d’un enfant, une séparation et une mort. L’histoire de Lou Bigelow et de Toby Maytree est une histoire tout aussi ordinaire et commune qu’elle n’est unique aux yeux des intéressés... puisque, tout simplement, c’est leur histoire. Et installés dans un petit village de pêcheurs à la pointe du Cap Cod, adeptes d’une vie spartiate, sans voiture ni télévision pour les détourner de ce qui est pour eux l’essentiel – la poésie, la peinture, et la beauté de l’infini des dunes posées entre le ciel et l’océan -, les Maytree ont beau être ce genre de gens dont le nez est perpétuellement plongé dans un livre, toute cette littérature ne leur est d’aucune utilité, ainsi que le note Lou: "L’amour lui avait si soudainement bondi dessus qu’elle pensait sérieusement que personne n’avait jamais analysé d’un peu près ce phénomène. Où en était-il question dans la littérature? Quelqu’un avait bien dû écrire quelque chose à ce sujet? Ça avait dû lui échapper. Il était temps de tout relire." (p. 45)
De ce paradoxe d’une histoire à la fois si commune et si personnelle, Annie Dillard a su tirer parti – par un humour à froid qui ne va pas tout à fait jusqu’au sourire, et par un ajustement perpétuel du regard, du distancié au plus intime - pour faire de son "Amour des Maytree" un roman universel et unique, sans décidément plus rien d’ordinaire. Un roman parcouru aussi des embruns balayant la pointe du Cap Cod, des parfums des pinèdes du Maine - "La beauté du Maine n’est pas du ciel, mais de la terre. La lumière du soleil tombait sur des pins noirs, et mourait, ou bien se répandait sur les champs. Cette froide forêt finit par le séduire. Les aiguilles de pin qu’on foulait aux pieds devinrent son sable. Il humait l’humus noir, humait le roc à l’odeur de tuyau mouillé." (p. 136) -, ou encore des allers et venues de toute une communauté d’estivants – artistes, universitaires new yorkais en quête d’air pur et d’espace - excentriques et quelque peu bohêmes. Un roman aux multiples échos sous ses dehors modestes, et qui m’a bien donné l’envie de poursuivre au plus tôt ma découverte de l’oeuvre d’Annie Dillard...
Extrait:
"Certes, il avait pensé qu’il aimerait Lou et resterait avec elle pour toujours. Une vie entière, s’était-il imaginé, ne serait pas assez longue. (Pourquoi se donnait-il tant de mal et pour entraîner sa mémoire si elle ne devait que le tarabuster?) Mais, bien sûr, durant presque toute l’histoire de l’espère humaine, l’espérance de vie avait tourné autour de dix-huit ans. Les quatorze années où il avait honoré son mariage avec Lou auraient naguère probablement constitué un record du monde d’endurance. Il avait déjà passé avec une seule et unique personne l’équivalent de plusieurs vies monogames d’autrefois. Il avait quarante-quatre ans. Il n’avait jamais vraiment aimé Lou, il s’en apercevait maintenant. Il s’était seulement aimé lui-même à travers ses yeux. Son silence était du papier blanc sur lequel il écrivait. Elle aimait plus que tout le rendre heureux. Dans ces conditions, s’appartenait-il lui-même, ou non?" (p. 96)


/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F3%2F137165.jpg)