“Les travaux et les jours”
“L’énigme de l’arrivée” de V.S. Naipaul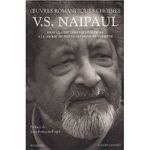
4 ½ étoiles
in “Œuvres romanesques choisies”, Robert Laffont/Bouquins, pp. 637-928
(traduit de l’Anglais par Suzanne Mayoux)
“J’avais beaucoup écrit, accompli un travail d’une grande difficulté; j’avais travaillé sous pression pratiquement depuis que j’avais quitté l’école. Avant d’écrire, il avait fallu apprendre; l’écriture m’était venue lentement. Avant cela j’avais été à Oxford; encore avant, au collège où je m’étais préparé pour décrocher la bourse d’étude à Oxford. La carrière d’écrivain ne consistait pas en un état – de compétence, de réussite, de notoriété ou de satisfaction – auquel on parviendrait, et dans lequel on demeurerait. Il existait une angoisse particulière liée à cette carrière: quel que fût le labeur à fournir pour chaque œuvre d’écriture, quels qu’en fussent les défis de créativité ou les satisfactions, le temps m’en avait chaque fois éloigné. Et, à mesure que le temps passait, l’œuvre déjà accomplie me donnait l’impression de se rire de moi, elle semblait appartenir à une époque de vigueur, désormais révolue. Le sentiment du vide, l’agitation me reprenaient; et il me fallait une fois de plus, en puisant dans mes seules ressources, entreprendre un nouveau livre, me consacrer à nouveau à ce processus dévorant.” (p. 719)
Tel est tout justement l’état d’esprit de V.S. Naipaul lorsqu’il s’installe vers la fin des années 1960 dans un petit hameau du Wiltshire, un de ces lieux où l’on croirait volontiers – et bien à tort – qu’il ne se passe jamais rien. Il vient alors d’essuyer une sévère déconvenue, son dernier manuscrit – un ouvrage consacré à son île natale de Trinidad – ayant été refusé par l’éditeur qui l’avait commandé. Il ne lui reste plus alors qu’à se remettre au travail, et à écrire un nouveau livre, qui devait devenir “Dans un état libre”: “un livre violent, non pas dans ses péripéties mais dans ses émotions. C’était un livre sur la peur. Cette peur étouffait toute plaisanterie. Et le brouillard qui régnait sur la vallée pendant que j’écrivais, la nuit qui tombait tôt dans l’après-midi, le fait de ne rien connaître des lieux où je me trouvais, bref toute l’incertitude qui émanait pour moi de la vallée, je la transposai sur mon Afrique.” (p. 718)
Cherchant un refuge où écrire dans le calme et la tranquillité, V.S. Naipaul découvre ainsi la campagne anglaise près de dix ans après avoir posé pour la première fois le pied sur le sol britannique. Au fil des saisons, il en apprivoise petit à petit les beautés, en assimile le vocabulaire, les noms des plantes et des animaux. Il noue des relations de bon voisinage, avec Jack, avec Mr et Mrs Phillips, avec Pitton le jardinier, et pousse lentement ses racines dans ce coin de campagne paisible. Il se fait sensible enfin au changement continuel qu’impose à un environnement devenu familier le passage des années. Et c’est peut-être tout justement dans ce mariage poignant de la beauté et de la fragilité que réside un des grands charmes de ce livre.
Récit autobiographique, certes, mais plus sûrement texte inclassable, “L’énigme de l’arrivée” – titre donné par Guillaume Appolinaire à un tableau de jeunesse de Giorgio de Chirico, auquel V.S. Naipaul l’a emprunté à son tour – mêle donc une lente méditation sur les effets du passage du temps à un retour de l’auteur sur le parcours qui a mené un jeune garçon dont la connaissance du monde était purement livresque et terriblement abstraite, - sa perception du Londres des années 1950 entièrement conditionnée par ses lectures de Dickens – à trouver sa voix et à réunir en lui l’homme et l’écrivain, ce qui n’est jamais que le début d’un autre voyage, l’œuvre accomplie s’effaçant devant celle encore à écrire. L’énigme de l’arrivée étant peut-être tout simplement que, vivant, on n’arrive jamais nulle part: “Le thème c’était la mort ; elle avait peut-être été là tout au long. La mort et la manière de se comporter face à elle, tel était le thème de l’histoire de Jack.” (pp. 919-920).
Faut-il dès lors encore préciser que ce livre étrange, poignant et magnifique est un jalon indispensable dans l’œuvre de V.S. Naipaul?
D'autres livres de V.S. Naipaul dans mon chapeau: "Le regard de l'Inde", "Dans un état libre", "A la courbe du fleuve" et "Among the believers: an islamic journey".
V.S. Naipaul était l'auteur des mois de juin et juillet 2010 sur Lecture/Ecriture.


/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F3%2F137165.jpg)









