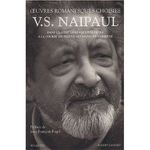Une amitié passionnelle
"Les Braises" de Sándor Márai
4 ½ étoiles
Le livre de poche, 2009, 219 pages, isbn 9782253933786
(traduit du Hongrois par Marcelle et Georges Régnier)
Au terme d'une séparation de quarante et un ans, le général est – enfin – sur le point de revoir Conrad, son camarade de l'école militaire auquel le liait une amitié qu'il ne serait sans doute pas exagéré de qualifier de passionnelle. Au temps de leur jeunesse, dans cette école où "du matin au soir, les élèves apprenaient ce que l'on ne devait pas dire" (p. 35), les deux garçons étaient inséparables, en dépit de leur différences sociales et intellectuelles. Et c'est Conrad qui avait présenté au général Christine, sa future épouse... Mais quarante et un ans avant la soirée de retrouvailles dont Sándor Márai nous fait le récit dans ce très beau roman, un drame les a séparés: Conrad est parti en Extrême-Orient, Christine est morte et le général, une fois libéré des obligations de son service, s'est cloîtré dans le château familial au plus profond des forêts hongroises.
Récit de la naissance, de la vie et de la mort d'une amitié à l'exigence extrême, "Les Braises" est aussi – à travers la figure du général, homme en définitive égaré dans une époque qui n'est pas la sienne – un portrait de l'empire austro-hongrois jetant ses derniers feux, de ses valeurs et de son art de vivre. C'est un récit de disparition, de perte et de fidélité par-delà l'inéluctable marche du temps, un récit mélancolique et digne que la plume sensible de Sándor Márai pare d'une séduction aussi douce qu'irrésistible, et dont les interrogations demeurent, au-delà du temps et des vies qui les ont vus naître pour atteindre de plein fouet les lecteurs d'aujourd'hui, puisque "aux questions les plus graves, nous répondons en fin de compte, par notre existence entière. Ce que l'on dit entre temps n'a aucune valeur, car lorsque tout est achevé, on répond avec l'ensemble de sa vie aux questions que le monde vous a posées. Les questions auxquels il faut répondre sont: Qui es-tu? Qu'as-tu fait?... A qui es-tu resté fidèle? A quel propos as-tu été infidèle?" (pp. 115-116)
Extraits:
"Ils regardèrent alors un moment le spectacle qui s'offrait à leurs yeux: la grande pièce et les lourds meubles qui avaient conservé le souvenir d'une heure ou seulement d'une minute. Les étoffes des tentures, les bois et les métaux avaient d'abord simplement existé, mais quarante et une années auparavant, un instant leur avait insufflé la vie. Cet instant unique était devenu leur raison d'être. Et voilà que maintenant ils avaient repris la vie et semblaient aux-mêmes se souvenir." (p. 49)
"Le général suivait chacun de ses mouvements. Maintenant que son ancien ami, comme dominé par la magie des lieux, s'était assis dans le même fauteuil, à l'endroit précis où il s'était assis quarante et un ans auparavant, il se sentait comme soulagé. Enfin, tout se trouvait à sa place, estimait-il?" (p. 72)
Un autre livre de Sándor Márai, dans mon chapeau: "Métamorphoses d'un mariage"


/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F3%2F137165.jpg)