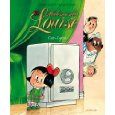Le premier atlas scientifique de Belgique
"Le grand atlas de Ferraris",
Bibliothèque royale de Belgique (Palais de Charles de Lorraine)
Le grand atlas des Pays-Bas méridionaux, réalisé entre 1771 et 1778 par le comte de Ferraris, en réponse à une commande de l'impératrice Marie-Thérèse, est passé à la postérité comme le premier véritable atlas scientifique de ce qui deviendrait plus tard la Belgique. Et ce document de première importance, qui nous renseigne aussi bien sur les ressources naturelles (mines, forêts...) que sur l'urbanisme ou la topographie du pays à la fin du XVIIIème siècle, vient d'être réédité conjointement par Racine et Lanoo, en même temps que l'intégralité des cartes qui le constituent étaient rendues accessibles en ligne, sur le site de la Bibliothèque Royale.
L'événement méritait bien une célébration particulière. La Bibliothèque Royale a donc mis les petits plats dans les grands pour nous proposer, dans le décor somptueux de l'ancien palais de Charles de Lorraine (qui fut gouverneur des Pays-Bas de 1741 à 1780, au nom de sa belle-soeur, l'impératrice Marie-Thérèse, et l'un des promoteurs du projet du comte de Ferraris), une exposition - petite mais fort intéressante - replaçant le grand atlas dans le contexte, en particulier politique et scientifique, de son époque. On y découvrira, aux côtés d'anciens traités d'arpentage et du matériel de dessin (planchettes, pantographe...) alors en usage, des réimpressions en grand format de quelques cartes significatives de l'atlas de Ferraris: c'est l'occasion de découvrir Ostende bien avant la grande vogue des bains de mer, en minuscule ville de garnison, enserrée dans ses murailles, ou encore la présence monumentale de la cathédrale Saint-Lambert (détruite lors de la Révolution liégeoise, à la fin du XVIIIème siècle) dominant la ville épiscopale.
Cette exposition est gratuite, et accessible deux après-midis par semaine:
- Les mercredi et jeudi, de 13h à 17h, pendant les mois de juillet et août.
- Les mercredi et samedi, de 13h à 17h, durant le mois de septembre.
C'est à Bruxelles, dans l'ancien palais de Charles de Lorraine, situé place des musées, à deux pas des Musées Royaux des Beaux-Arts et du tout nouveau Musée Magritte.
Pour en savoir plus:


/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F3%2F137165.jpg)