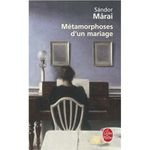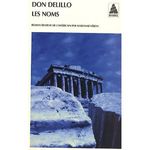"Les noms" de Don DeLillo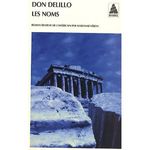
4 étoiles
Actes Sud/Babel, 2008, 467 pages, isbn 9782760927735
(traduit de l’Anglais par Marianne Véron)
Son mariage sombrant dans la déliquescence, et son épouse ayant décidé de prendre un emploi dans un chantier de fouilles archéologiques sur une petite île perdue des Cyclades, James Axton a également décidé d'accepter un poste à Athènes, afin de rester proche de son fils Tap. Analyste pour une compagnie d'assurances couvrant les firmes américaines opérant au Moyen-Orient contre les risques liés à des attaques terroristes (enlèvement, demande de rançon...), il nous décrit ainsi son travail: "En fait, je suis l’évolution politique et économique du pays en question. Nous avons un système très complexe de graduation. Les statistiques des prisons comparées au nombre de travailleurs étrangers. Combien de jeunes chômeurs de sexe masculin. Les salaires des généraux ont-ils été doublés. Qu’arrive-t-il aux dissidents. Les chiffres de production de coton ou de blé d’hiver cette année. Les sommes d’argent versées au clergé. Nous avons sur place des gens que nous appelons des points de contrôle. Le contrôle est toujours national, dans le pays en question. Ensemble, nous analysons les chiffres à la lumière des événements. Qu’est-ce qui paraît probable? L’effondrement, le renversement, la nationalisation? Peut-être des corps jetés dans des fosses. Tout ce qui peut mettre en danger des investissements." (p. 51)
L'époque est loin d'être calme - "c’était juste après le départ du chah*, avant la prise d’otages, avant la Grande Mosquée et l’Afghanistân"(p. 95) – et la besogne ne manque pas. Mais James n'en avoue pas moins: "Je commençais à me voir comme un éternel touriste. Cela avait quelque chose d'agréable. Etre un touriste, c'est échapper aux responsabilités. Les erreurs et les échecs ne vous collent pas à la peau comme ils feraient normalement. On peut se laisser glisser à travers les langues et les continents, suspendre l'opération de solide réflexion." (p. 63) Et à travers ses yeux, c'est de tout ce milieu d'affairistes américains - expatriés passant continuellement d'un grand hôtel impersonnel à un autre, d'un avion à un autre, vivant dans leur propre bulle déconnectée du monde réel et du jeu des causes et de leurs conséquences – que Don DeLillo dresse un tableau implacable. Une matière très riche à laquelle il vient encore entretisser une seconde intrigue, presque policière: l'enquête qui mène James sur les traces d'une secte dangereuse - elle ne recule pas devant le meurtre -, et dont le fond de commerce se nourrit d'une fascination mystico-morbide pour le langage, les mots et l'écriture. "L'alphabet est mâle et femelle. Si l'on connaît l'ordre juste des lettres, on fabrique un monde, on crée. C'est pourquoi ils cachent l'ordre. Si l'on connaît les combinaisons, on fait la vie et la mort." (pp. 211-212) Ce second fil conducteur du roman entraîne donc le lecteur sur la piste d'un thème cher au coeur de l'écrivain qui y reviendra d'ailleurs dans "Body Art": le langage, sa puissance et ses limites, ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas et ce qu'il dit parfois à son corps défendant.
Des grandes manoeuvres des intérêts politiques et des stratégies économiques à la mystique des mots, l'écart est pourtant bien moins grand que l'on ne pourrait le croire de prime abord. En ces temps troublés où les pays changent de noms comme les hommes de chemises, certains des personnages des "noms" ne savent que trop que derrière ces modifications de façade se cache la fin du monde tel qu'ils le connaissaient: "- Je le disais à Ann. Ils n'arrêtent pas de changer les noms.
- Quels noms?
- Les noms avec lesquels nous avons grandi. Les pays, les images. La Perse, par exemple. Nous avons grandi avec la Perse. Quelle vaste image ce nom évoquait. Un immense tapis de sable, mille mosquées turquoise. Une immensité, une gloire cruelle qui s'étendait sur des siècles. Tous ces noms. Une douzaine ou davantage, et maintenant la Rhodésie, bien sûr. La Rhodésie disait quelque chose. Pour le meilleur ou pour le pire, c'était un nom qui disait quelque chose. Qu'offrent-ils à la place? Une arrogance linguistique, voilà ce que je lui ai dit." (pp. 330-331)
Alors que ni la valse des noms ni les grandes manoeuvres stratégiques n'ont cessé, force m'est donc de constater que ce livre publié pour la première fois il y a près de trente ans, et que sa quatrième de couverture décrit à juste titre comme "un grand roman politique paranoïaque et labyrinthique", n'a pas pris une seule ride.
* Les événements que Don DeLillo a imaginés ici sont donc à peu près contemporains du long périple de V.S. Naipaul à travers l'Orient musulman, dont le récit dans "Crépuscule sur l'Islam" nous livre un regard sur cette période radicalement différent, et complémentaire, à celui proposé par "Les noms".
Extrait:
"Tous ces endroits étaient pour nous des récits d’une seule phrase. Quelqu’un arrivait, prononçait une phrase sur les lézards de trente centimètres qu’il avait trouvés dans sa chambre à Niamey, et cette phrase devenait la matière solide de l’endroit, le moyen que nous employions pour le fixer dans notre esprit. La phrase était efficace, nappant des peurs plus profondes, des incertitudes, une angoisse. Il n’y avait autour de nous presque rien qui nous parût familier et sûr. Seulement nos hôtels, surgissant des courants d’une intarissable rénovation. La perception des choses était si différente que nous ne pouvions enregistrer que les lisières de quelque secret compliqué. Il semblait que nous eussions perdu notre aptitude à choisir, à découvrir la singularitéet remonter sa trace, jusqu’à un centre que notre esprit pût situer dans un environnement reconnaissable. Il n’y avait pas de centre équivalent. Les forces étaient différentes, les ordres de réaction nous échappaient. Les temps et les inflexions. La vérité était différente, l’univers parlé, et l’on voyait partout des hommes armés.
Les récits en une seule phrase traitaient de nos griefs passagers ou de nos petits embarras. C’était l’humour de la peur cachée." (p. 133)
Un autre extrait, dans mon chapeau: ici
D'autres livres de Don DeLillo, dans mon chapeau: "Body Art", "Valparaiso" et "Coeur-saignant-d'amour"
Et d'autres encore sur Lecture/Ecriture, où Don DeLillo était l'auteur des mois de février et mars 2011.
 "Dragons et princesses" de Michel Ocelot
"Dragons et princesses" de Michel Ocelot

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F3%2F137165.jpg)