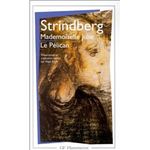La poésie n'est pas un long fleuve tranquille
"Le livre canoë (poèmes et autres récits)" de Serge Delaive
4 étoiles
Editions de la Différence/Clepsydre, 2001, 138 pages, isbn 2729113568
Bien avant de se faire romancier et de signer avec son "Argentine" une vraie réussite du genre, Serge Delaive était poète. Mais un poète qui déjà contait des histoires. Un poète qui, entre les pages de ses livres, offrait déjà tout un monde à ses lecteurs.
A travers les quatre sections du "livre canoë" ("Parabellum", "Postures", "Antipoèmes" et "De la littérature"), à travers aussi une grand diversité formelle mêlant de longues séquence de vers libres à des poèmes courts dont la brièveté relève quasiment de l'instantané photographique ou encore à quelques textes en prose, Serge Delaive nous entraîne vers les horizons lointains de Vientiane ou de Buenos Aires où l'on croisera d'ailleurs quelques silhouettes qui réapparaîtront dans "Argentine". Tour à tour lyriques ou bien bousculés et comme heurtés par un sentiment d'urgence, ses vers nous immergent dans des histoires de fuite, de morts violentes, de suicide et d'abandon, flirtant avec le doute, les traîtrises de la mémoire et le sentiment, troublant au dernier degré, de l'impossibilité-même de la littérature. Et pourtant...
Décidément, sous la plume de Serge Delaive, la littérature et certainement la poésie n'ont rien d'un long fleuve tranquille. Et ce n'est certes pas le lecteur, tantôt déstabilisé, surpris, ému ou conquis, qui s'en plaindra...
Extrait:
Postures
(...)
La mousson renonce
à la terre ocre et détrempée
livrée désormais
au soleil carnivore
Les palmiers aréquiers
vigiles haut perchés
suent d'huile et du bétel
que l'on chiquera
en épiant les signes
avant-coureurs d'un
imminent typhon
qui trace déjà
larges gestes circulaires
en travers du ciel retiré
son lavis lourd et ses franges
aquatintes.
(...)
(Vientiane)
Le lent
l'indolent charme
de Vientiane en sarong
s'émiette par les mailles lâches
des heures qui pendouillent
se délitant jusqu'à l'usure
avant de glisser en vrilles paresseuses
à l'improviste
sur la nuit poussiéreuse. (pp. 63-64 et p. 73)
Un autre extrait du "livre canoë", dans mon chapeau: "Sans doute".
D'autres livres de Serge Delaive, dans mon chapeau: "Argentine" et "Poèmes sauvages"


/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F3%2F137165.jpg)