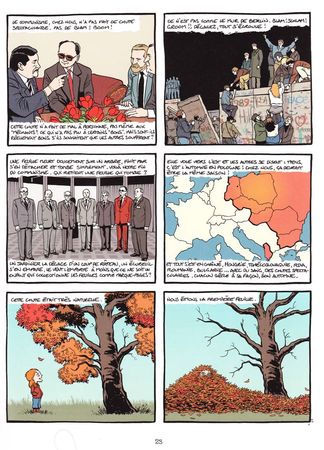"Les Onze" de Pierre Michon
5 étoiles
Verdier, 2009, 137 pages, isbn 9782864325529
On s’en approche à pas prudents. Sur la gauche. Puis sur la droite. On penche la tête pour s’affranchir d’un reflet dans la vitre pare-balles. On s’en éloigne. On se retourne pour lire le panneau explicatif placé à l’entrée de la salle. Littéralement, on tourne autour de ce tableau – "Les Onze", la représentation par François-Elie Corentin du Comité de salut public de 1794, un des plus beaux fleurons des collections du musée du Louvre.
On tourne autour, tant Pierre Michon multiplie les biais et les détours, pour nous évoquer – avec une rare puissance de suggestion - ce tableau parfaitement imaginaire. Oeuvre fictive d’un artiste qui l’est tout autant, mais dont l’auteur nous retrace ici longuement les origines et la vie, de sa naissance dans un modeste manoir des bords de Loire – fils d’un père absent qui sacrifia sa famille pour poursuivre sans succès la carrière des Lettres – à sa formation auprès de Giambattista Tiepolo, qui aurait prêté les traits de son jeune élève à l’un des pages des fresques du palais épiscopal de Wurtzbourg, et à son amitié avec Collot, membre – justement – du Comité de salut public.
Au fil des innombrables digressions et des longues périodes de la prose de Pierre Michon, l’illusion de réalité est parfaite. On croit vraiment pouvoir se retrouver face à ce tableau des "Onze", au détour d’un couloir du musée du Louvre. Tout comme on en vient sans peine à croire à l’existence de François-Elie Corentin. Cela seul est déjà, en soi, assez bluffant, mais c’est loin d’être tout ce qu’il y a à ce long récit d’une sombre beauté. Car on a rarement célébré, avec autant d’éloquence, les noces troubles de l’Art et du Politique. Ce que l’Art peut montrer, obéissant aux volontés de ses commanditaires, à leurs agendas les plus secrets et ambigus. Et plus encore ce que l’Art montre par-delà les volontés de ceux qui le paient - dépassant ainsi, et de loin, ceux qu’il était supposé servir. Ce mystérieux supplément d’âme que les artistes, parfois, pressentent, tel François-Elie Corentin recevant cette ultime et prestigieuse commande de la bouche de Collot: "Corentin ne rit pas. Peut-être qu’il n’écoute pas Collot, mais il le regarde. Il se dit avec une sorte de joie que le zèle compatissant pour les malheureux et la plaine des Brotteaux, la table inhospitalière et la lande de Macbeth, la main tendue et le meurtre, nivôse et avril, c’est dans le même homme. C’est dans Collot, un des onze hommes qu’il va peindre. Il se dit encore que tout homme est propre à tout. Que onze hommes sont propres à onze fois tout. Que cela peut se peindre." (p. 119)
Ce récit âpre et goûteux, magnifique d’intelligence, est le premier que je lis de Pierre Michon. Mais ce ne sera certainement pas le dernier, tant il me laisse en proie à une admiration sans mélange…
Extrait:
"Vous imaginez cela, Monsieur, au temps de la douceur de vivre? Elle n’est telle que parce qu’elle n’est plus, c’est vrai, mais comme il est doux d’y rassembler nos rêves, de leur donner la becquée dans ce nid germanique, oh à peine germanique, vénitien de par-delà, simplement. Ils viennent là au premier coup de trompette, nos rêves, ils connaissent le chemin. Ils accourent comme des poussins sous leur mère. Ils savent bien qu’elle est là, la douceur de vivre, - à moins qu’ils ne le croient increvablement. Le temps de la douceur de vivre, on veut donc croire que c’était, et c’était peut-être en vérité, celui où Giambattista Tiepolo de Venise, c’est-à-dire un géant, un homme de la carrure de Frédéric Barberousse, en plus pacifique, employait trois années de sa vie (trois années de la vie de Tiepolo, qui ne voudrait les voir sortir de son petit cornet à dés?) employait trois années au fond de la Germanie sur un plafond par-dessus un escalier, à montrer, peut-être à démontrer, comment les quatre continents, les quatre saisons, les cinq religions universelles, le Dieu trois qui est un, les Douze de l’Olympe, les quatre races d’hommes, toutes les femmes, toutes les marchandises, toutes les espèces, mais oui : - le monde -, comment donc le monde toutes affaires cessantes accourait des quatre orients pour faire hommage lige à Carl Philipp von Greiffenclau son suzerain, qui est peint au beau milieu au point de jonction des quatre orients, comme au quai de débarquement du fret universel, et dont on reçoit en plein l’image triomphale quand on arrive sur la dernière marche – Carl Philipp, suzerain des quatre orients, prince-évêque électeur, torve du visage, large de ceinture, d’épaules étroites, d’âge incertain, de pouvoir plus incertain, frotté de vers latins, d’escarcelle grande ouverte et de mœurs un peu dissolues car par ailleurs, sous son effigie sur les degrés de Carrare, il poursuivait à coups de cannes un rapin français qui lui soulevait des filles." (pp. 18 -19)
Peut-être les longues descriptions des fresques réalisées par Giambattista Tiepolo au palais épiscopal de Wurtzbourg vous donneront-elles l'envie de retrouver plus longuement le peintre vénitien. Aussi, voici quelques suggestions de lecture, autour de Tiepolo: "La ville invisible", beau roman d'Emili Rosales qui y évoque avec sensibilité la période madrilène du peintre, et bien sûr, "Giambattista Tiepolo - l'oeuvre peint" de Massimo Gemin et Filippo Pedrocco.
On trouvera aussi, sur la toile, une lecture des "Onze" par Angèle Paoli sur son blog Terres de femmes, une autre par Pierre Assouline sur La république des livres, et une autre encore par Mapero sur Wodka.



/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F3%2F137165.jpg)