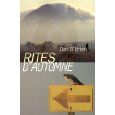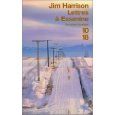Un plantureux cheese cake à l'Américaine
"Refaire le monde" de Julia Glass
3 1/2 étoiles
Editions des deux terres, 2009, 767 pages, isbn 978284930602
(traduit de l'Anglais par Sabine Porte)
Charlotte Greenaway Duquette, en dépit de son nom fleurant bon la Louisiane, est chef-pâtissière à New York où sa petite entreprise est florissante. Et elle mène une vie familiale plutôt heureuse avec son mari, Alan qui est psychothérapeute, et George leur petit garçon de quatre ans - à ceci près que depuis quelques mois, Alan est la proie d'une mélancolie inexpliquée mais de plus en plus affirmée, et qui commence à peser sérieusement à la jeune femme. Aussi, malgré les obstacles pratiques, la proposition inattendue qui lui est faite de devenir chef-cuisinière à la résidence officielle du gouverneur du Nouveau-Mexique, finit par prendre à ses yeux toutes les apparences d'une occasion en or, et pas seulement d'un point de vue professionnel: une occasion rêvée de faire bouger une vie qui menace de s'encroûter dans une situation assez confortable mais pas complètement satisfaisante pour autant.
Comme aux dominos, le coup de tête de Greenie - puisque tel est le surnom que ses intimes donnent à Ms Duquette - amènera de proche en proche bien d'autres changements. Et c'est le début d'un jeu de cloche-merle - façon "Je t'aime, moi non plus" - qui nous tiendra en haleine pendant 760 pages au long desquelles nous aurons aussi bien souvent l'eau à la bouche à l'évocation des somptueuses et savoureuses créations de Greenie. Julia Glass déploie ici un fabuleux talent de conteuse mêlée à un sens affiné du détail révélateur - d'un caractère, d'un état d'esprit ou d'une atmosphère. On s'attache vraiment à des héros très ordinaires dans leurs forces et leurs faiblesses, même si leurs silhouettes semblent parfois évadées du papier glacé d'un magazine "Lifestyle". Et la progression dramatique du récit est si savamment dosée qu'on ne s'ennuie pas une minute.
Je me suis régalée - presque - tout au long de ma lecture de ce gros roman onctueux et riche - un peu trop - à l'égal d'une part de ce plantureux cheese cake dont l'Amérique du Nord a le secret, et j'étais bien tentée d'accorder 4 étoiles à "Refaire le monde"... Jusqu'au deus ex machina final - les attentats du 11 septembre 2001, ben oui... - qui amène chacun des personnages à reconsidérer ses choix et à se fixer enfin à une nouvelle place. Après le monde de couleurs et de saveurs que Julia Glass nous a offert dans les trois premiers quarts de son livre, cela vous a toutes les apparences d'une solution de facilité, d'autant que son traitement de cet événement reste assez convenu et n'apporte rien de neuf. Pour être franche, j'en veux un peu à l'auteur de ne pas s'être montrée plus imaginative pour l'occasion. Mais "Refaire le monde" n'en reste pas moins une très bonne lecture d'évasion.
Extrait:
"Sur ce, on lui apporta la petite gourmandise auréolée de vapeur qui ressemblait davantage à un chapeau marron avachi. Elle respira la vapeur qui s'en dégageait. Celle-ci lui rappela tristement le parfum de l'homme assis à la table d'à côté. Elle le mangea tout de même: lentement et jusqu'à la dernière bouchée. Le soufflé avait la texture de l'amour, suave et aérienne, chaude et humide; le goût n'importait guère." (pp. 543-544)


/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F3%2F137165.jpg)