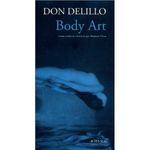Des passions et de leurs sanctions
"Histoire de la princesse de Montpensier" de Madame de Lafayette
4 étoiles
Gallimard/Folio, 2010, 131 pages, isbn 9782070360949
A la lecture des trois nouvelles rassemblées ici, sous le titre de la première et de la plus longue d'entre elles, on ne peut que reconnaître en madame de Lafayette la digne contemporaine de Corneille et de Racine. La passion amoureuse y déroule en effet sa mécanique implacable, à l'issue forcément tragique, dans une langue à la beauté classique et épurée, bien loin de tout pathos.
C'est que le "Va, je ne te hais point" de Chimène à Rodrigue n'aurait sans doute pas déparé dans la bouche des trois héroïnes dont madame de Lafayette nous conte ici le triste sort. Que ce soit la princesse de Montpensier ("Histoire de la princesse de Montpensier") prise au piège entre la jalousie de son mari, l'amour non payé de retour que lui portent le duc d'Anjou (futur roi de France sous le nom d'Henri III) ou le comte de Chabannes, et sa passion partagée pour le duc de Guise. Ou la comtesse de Tende ("Histoire de la comtesse de Tende"), prise d'une passion violente pour l'homme qu'elle avait pourtant aidé à conquérir une autre femme en la personne de sa meilleure amie, la princesse de Neuchâtel. Ou encore la pauvre Bélasire ("Histoire d'Alphonse et de Bélasire") que la jalousie de son fiancé a finalement poussée à trouver refuge dans un couvent des plus austères. De toute façon, c'est au lecteur qu'il revient le plus souvent d'imaginer les gestes et les paroles de personnages dont madame de Lafayette a choisi de ne nous proposer pour l'essentiel qu'une analyse distanciée et parfois même moralisatrice – au lecteur ou au scénariste de la récente adaptation de l'histoire de la princesse de Montpensier par Bertrand Tavernier, dont je suis à présent fort curieuse de découvrir la vision de ce texte certes d'un autre temps mais qui ne s'en lit pas moins avec un grand plaisir.
Extrait:
"La princesse de Montpensier demeura affligée et troublée, comme on se le peut imaginer; de voir sa réputation et le secret de sa vie entre les mains d'un prince qu'elle avait maltraité et d'apprendre par lui, sans pouvoir en douter, qu'elle était trompée par son amant étaient des choses peu capables de lui laisser la liberté d'esprit que demandait un lieu destiné à la joie. Il fallut pourtant y demeurer, et aller souper ensuite chez la duchesse de Montpensier sa belle-mère, qui la mena avec elle." (p. 45)


/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F3%2F137165.jpg)